L’AFONT reproduit les quelques paragraphes que Paul Valéry a consacrés à la main dans son Discours aux chirurgiens (1938). Dans un style parfois contourné, ailleurs allusif, il fait alterner certaines idées typiques de son temps avec quelques intuitions d’avant-garde.
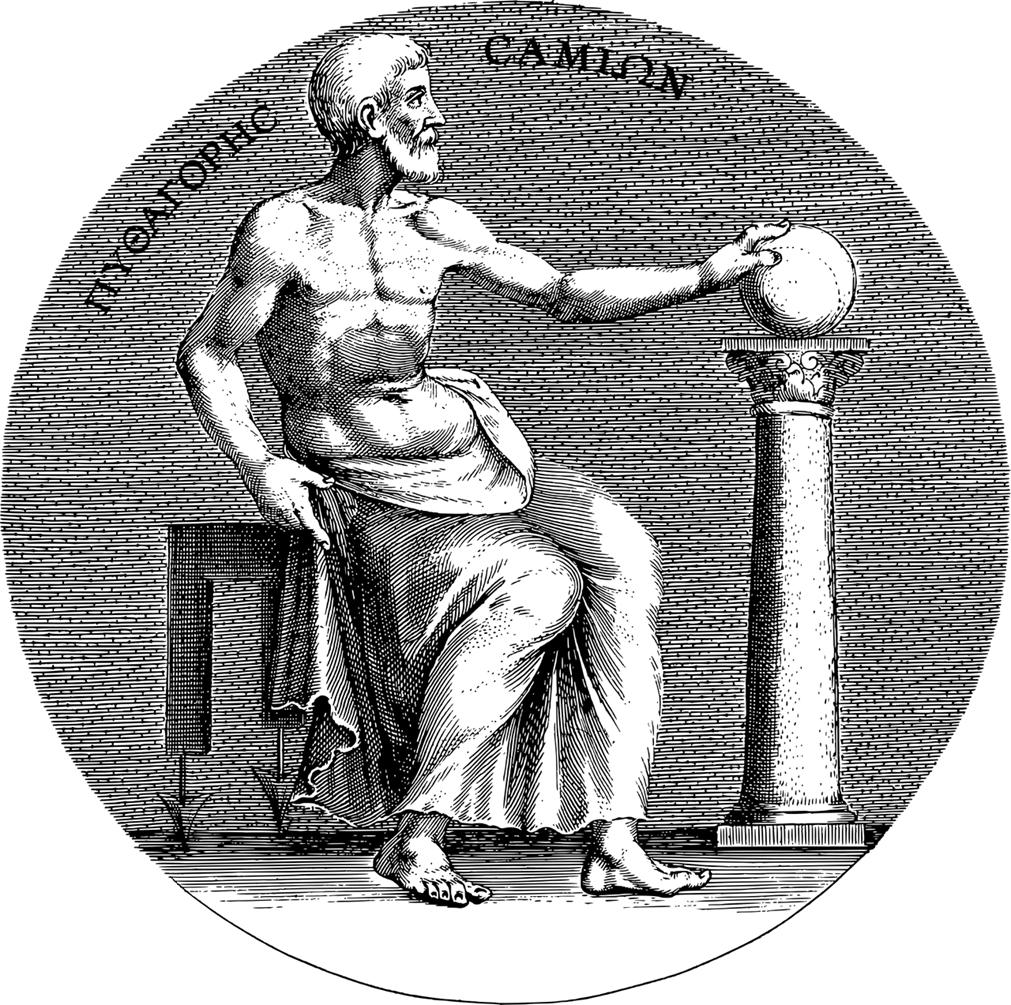
Le 17.10.1938, à la faculté de médecine de Paris, Paul Valéry (1871-1945), un des penseurs officiels de l’entre-deux-guerres en France, prenait la parole devant le congrès de chirurgie. La quinzaine de pages de cette intervention fut reprise en 1944 dans Variétés V, et l’extrait allant de « Manuopera » jusqu’à « certitude positive » parut séparément, en 1949, en conclusion du livre d’art À la gloire de la main, aux côtés de textes de Bachelard, Éluard, Lescure, Mondor, Ponge, De Solier et Tzara, accompagnés de gravures de Boumeester, Chastel, Courtin, Durand, Fautrier, Fiorini, Flocon, Goetz, Prébandier, Richier, Signovert, Ubac, Vieillard, Villon, Villiany et Yersin.
Comme l’écrasante majorité des penseurs occidentaux, Valéry commence par admirer la main pour ses capacités motrices et productrices: le faire. Mais il a très vite l’intuition que cette créativité n’est possible que grâce au sentir: parce que la main est «habile et instruite à lire, de la pulpe de sa paume et de ses doigts». Il en viendra à la décrire comme «cette machine prodigieuse qui assemble la sensibilité la plus nuancée aux forces les plus déliées», et posera qu’«Il faut des mains, non seulement pour réaliser, mais pour concevoir l’invention la plus simple sous forme intuitive».
Valéry s’oppose ainsi (de manière implicite) au lieu commun académique qui fait de la distance du regard la condition de l’abstraction. De même, sans citer les nombreuses expressions qui font de la lumière le symbole de la pensée, il affirme que «notre vocabulaire le plus abstrait est peuplé de termes qui sont indispensables à l’intelligence, mais qui n’ont pu lui être fournis que par les actes ou les fonctions les plus simples de la main». On retrouve finalement cette idée dans le jeu entre le sens chirurgical et le sens mathématique du nom «opération»: «la chirurgie est l’art de faire des opérations […] avec un certain système d’actes, une précision des manœuvres, une rigueur dans leur suite et leur exécution qui donnent à son intervention je ne sais quel caractère abstrait».
Les notes intercalées en italique dans le texte sont de Bertrand Verine.
[…] Toute la science du monde n’accomplit pas un chirurgien. C’est le Faire qui le consacre.
Le nom même de votre profession, Messieurs, met ce faire en évidence, car Faire est le propre de la main. La vôtre, experte en coupes et en sutures, n’est pas moins habile et instruite à lire, de la pulpe de sa paume et de ses doigts, les textes tégumentaires [note 1], qui vous deviennent transparents; ou, retirée des cavités qu’elle a explorées, elle peut dessiner ce qu’elle a touché ou palpé dans son excursion ténébreuse.
[Note 1. Les téguments (du verbe latin signifiant «couvrir») désignent l’ensemble des tissus qui couvrent le corps des animaux (peau, fourrure, plumage, écailles, etc.).]
Chirurgie, manuopera [note 2], manœuvre, œuvre de main.
[Note 2. La racine grecque «chir» désigne la main et «urg» signifie faire. «Manuopera» est le nom latin d’où provient le français «manœuvre», littéralement «travaux effectués avec la main».]
Tout homme se sert de ses mains. Mais n’est-il pas significatif que depuis le XIIe siècle, ce terme Œuvre de main ait été spécialisé au point de ne plus désigner que le travail d’une main qui s’applique à guérir?
Mais que ne fait point la main? Quand j’ai dû penser quelque peu à la chirurgie, en vue de la présente circonstance, je me suis pris à rêver assez longtemps sur cet organe extraordinaire en quoi réside presque toute la puissance de l’humanité, et par quoi elle s’oppose si curieusement à la nature, de laquelle cependant elle procède. Il faut des mains pour contrarier par ci, par là, le cours des choses, pour modifier les corps, les contraindre à se conformer à nos desseins les plus arbitraires [note 3]. Il faut des mains, non seulement pour réaliser, mais pour concevoir l’invention la plus simple sous forme intuitive. Songez qu’il n’est peut-être pas, dans toute la série animale, un seul être autre que l’homme, qui soit mécaniquement capable de faire un nœud de fil; et observez, d’autre part, que cet acte banal, tout banal et facile qu’il est, offre de telles difficultés à l’analyse intellectuelle que les ressources de la géométrie la plus raffinée doivent s’employer pour ne résoudre que très imparfaitement les problèmes qu’il peut suggérer.
[Note 3. De nombreux chercheurs critiquent aujourd’hui la conception des rapports entre l’homme et la nature qu’impliquent des mots comme «s’opposer, contrarier, contraindre, arbitraire». Cette critique est aussi bien le fait des sciences exactes (avec les recherches fondées sur le biomimétisme ou bio-inspirées, notamment) que des sciences humaines (qui revalorisent les conceptions amérindiennes ou océaniennes, par exemple).]
Il faut aussi des mains pour instituer un langage, pour montrer du doigt l’objet dont on émet le nom, pour mimer l’acte qui sera verbe, pour ponctuer et enrichir le discours.
Mais j’irai plus avant. J’irai jusqu’à dire qu’une relation réciproque des plus importantes doit exister entre notre pensée et cette merveilleuse association de propriétés toujours présentes que notre main nous annexe. L’esclave enrichit son maître, et ne se borne pas à lui obéir. Il suffit pour démontrer cette réciprocité de services de considérer que notre vocabulaire le plus abstrait est peuplé de termes qui sont indispensables à l’intelligence, mais qui n’ont pu lui être fournis que par les actes ou les fonctions les plus simples de la main. Mettre; – prendre; – saisir; – classer; – tenir; – poser, et voilà: synthèse, thèse, hypothèse [note 4], supposition, compréhension… Addition se rapporte à donner, comme multiplication et complexité à plier.
[Note 4. La famille lexicale de «thèse» vient du verbe grec signifiant l’action de poser.]
Ce n’est pas tout. Cette main est philosophe. Elle est même, et même avant Saint Thomas l’incrédule, un philosophe sceptique [note 5]. Ce qu’elle touche est réel. Le réel n’a point, ni ne peut avoir, d’autre définition. Aucune autre sensation n’engendre en nous cette assurance singulière que communique à l’esprit la résistance d’un solide. Le poing qui frappe la table semble vouloir imposer silence à la métaphysique, comme il impose à l’esprit l’idée de la volonté de puissance.
[Note 5. Signifiant littéralement en grec «observateur», «sceptique» désigne au sens fort une «personne qui pratique l’examen critique, le doute scientifique» (Le Grand Robert en ligne).]
Je me suis étonné parfois qu’il n’existât pas un «Traité de la main» [note 6], une étude approfondie des virtualités innombrables de cette machine prodigieuse qui assemble la sensibilité la plus nuancée aux forces les plus déliées. Mais ce serait une étude sans bornes. La main attache à nos instincts, procure à nos besoins, offre à nos idées, une collection d’instruments et de moyens indénombrables. Comment trouver une formule pour cet appareil qui tour à tour frappe et bénit, reçoit et donne, alimente, prête serment, bat la mesure, lit chez l’aveugle, parle pour le muet, se tend vers l’ami, se dresse contre l’adversaire, et qui se fait marteau, tenaille, alphabet?… Que sais-je? Ce désordre presque lyrique suffit. Successivement instrumentale, symbolique, oratoire, calculatrice, –agent universel, ne pourrait-on la qualifier d’organe du possible?– comme elle est, d’autre part, l’organe de la certitude positive?
[Note 6. Bien qu’il n’ait pas l’ampleur d’un «traité», l’Éloge de la main d’Henri Focillon date de 1934, quatre ans avant le propos de Valéry.]
Mais parmi toutes les notions qui dérivent de la généralité par laquelle cette main se distingue des organes qui ne savent faire qu’une seule chose, il en est une dont le nom s’associe étroitement à celui de la chirurgie.
La chirurgie est l’art de faire des opérations. Qu’est-ce qu’une opération? C’est une transformation obtenue par des actes bien distincts les uns des autres, et qui se suivent dans un certain ordre vers un but bien déterminé. Le chirurgien transforme l’état d’un organisme. C’est dire qu’il touche à la vie; il se glisse entre la vie et la vie, mais avec un certain système d’actes, une précision des manœuvres, une rigueur dans leur suite et leur exécution qui donnent à son intervention je ne sais quel caractère abstrait. Comme la main distingue l’homme des autres vivants, ainsi les voies abstraites distinguent le procédé de l’intelligence des modes de transformation de la nature.
«Tantôt je pense et tantôt je suis»
[…] Nous vivons sans être obligés de savoir que cela exige un cœur, des viscères, tout un labyrinthe de tubes et de fils, tout un matériel vivant de cornues et de filtres, grâce auquel il se fait en nous un échange perpétuel entre tous les ordres de grandeur de la matière et toutes les formes de l’énergie, depuis l’atome jusqu’à la cellule, et depuis la cellule jusqu’aux masses visibles et tangibles de notre corps. Tout cet appareillage enveloppé ne se fait soupçonner que par les aises et les douleurs qui s’y engendrent çà et là, qui s’imposent à la conscience, et qui la réveillent en tel ou tel point, interrompant ainsi le cours naturel de notre fonctionnelle ignorance de nous-mêmes…
Fonctionnelle, –j’ai dit fonctionnelle, en parlant de notre ignorance de notre corps, à nous autres, simples mortels. Je m’excuse d’avoir emprunté (avec plus ou moins de bonheur) ce terme imposant au vocabulaire [de la médecine] que je ne dois point employer. Mais il me semble qu’il fait bien ici, –et même que cette alliance de mots dit quelque chose. Elle dit, je crois, que notre ignorance de notre économie joue un rôle positif dans l’accomplissement de certaines de nos fonctions, qui ne sont pas, ou qui sont peu, compatibles avec une conscience nette de leur jeu; qui n’admettent guère de partager entre l’être et le connaître, qui ne répondent par l’acte à l’excitation, que si l’attention intellectuelle est nulle ou presque telle. Il arrive parfois qu’une personne particulièrement consciente soit obligée de distraire son esprit pour obtenir de soi l’accomplissement d’un acte qui doit être réflexe ou ne peut être. On voit alors cette curieuse circonstance se produire: la conscience et la volonté prendre parti pour le réflexe, contre la tendance de la connaissance à observer le phénomène, et par là, à le paralyser dans son cours éminemment naturel.
En somme, il est des fonctionnements qui préfèrent l’ombre à la lumière; ou tout au moins la pénombre, –c’est-à-dire le minimum de présence de l’esprit qui est nécessaire et suffisant pour préparer ses actes à s’accomplir ou pour les amorcer. À peine de défaillance ou d’arrêt, ils exigent que le cycle de sensibilité et de puissance motrice soit parcouru sans observations ni interruption depuis l’origine jusqu’à la limite physiologique de l’acte. Cette jalousie, cette sorte de pudeur de nos automatismes est bien remarquable; on en pourrait tirer toute une philosophie que je résumerais ainsi: Tantôt je pense et tantôt je suis.
L’esprit ne doit donc pas se mêler de tout, –quoiqu’il se soit découvert cette vocation. On dirait qu’il n’est fait que pour ne s’employer qu’à nos affaires extérieures. Quant au reste, à nos activités de base, une sorte de raison d’État les couvre. Le secret leur est essentiel, et cette considération permettrait peut-être de mesurer l’importance vitale de nos divers fonctionnements, par leur intolérance à l’égard de la conscience attentive. Soyons distraits pour vivre…
Référence
Valéry, Paul, 1938, «Discours aux chirurgiens», Variétés V, dans Œuvres I, Gallimard, pages 918-919 et 915-916.
Photographie d’illustration: Gordon-Johnson pour Pixabay.com

Commentaires récents