Nous rapprochons deux textes qui illustrent le malentendu actuel autour des mots «immersion» et «immersif» dans les domaines de la création artistique et de la médiation culturelle. «Plonger»… par l’esprit seul ou aussi par le corps? dans le discours ou dans le monde?
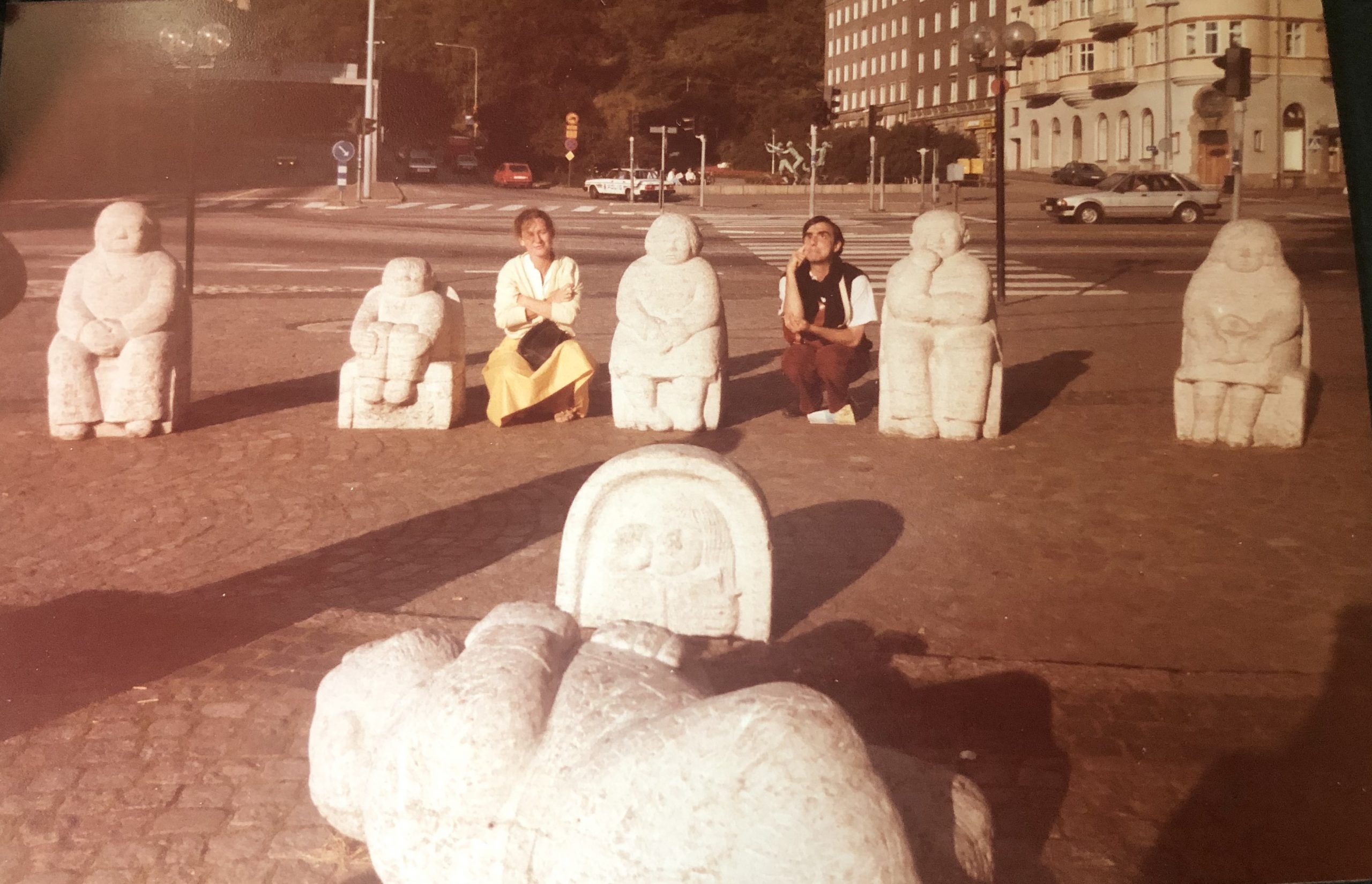
En 2006, dans son essai Bardadrac, le grand poéticien Gérard Genette persiflait «cette tendance si courante, chez les historiens « de l’art », à réduire, d’abord, l’art aux arts plastiques, ensuite les arts plastiques à la peinture, et enfin la peinture à celle de la Renaissance italienne». On peut aujourd’hui transposer la critique à de nombreux créateurs et médiateurs numériques qui réduisent, d’abord, l’immersion à la modification des conditions de réception sensorielle, ensuite la réception sensorielle au regard, et enfin le regard à la perception de la lumière.
La journaliste culturelle Sophie Rahal témoignait ainsi du malentendu dans son compte rendu de l’exposition Dans ma peau au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, le 28 mars 2019: «aujourd’hui servi à toutes les sauces, l’adjectif [immersif] signifie simplement qu’on pénètre dans un tunnel représentant les différentes couches de la peau, au bout duquel s’enfilent des salles couleur rosé, beige, chair, où vidéos et consoles agrémentent le parcours» (www.telerama.fr). Or «s’immerger» devrait aussi pouvoir signifier que celle ou celui qui participe plonge de tous ses sens dans une version modifiée ou augmentée de la réalité habituelle, voire dans une autre réalité.
«S’immerger dans la lumière»?
Dans son titre (très codé), son introduction et sa conclusion, le philosophe Bernard Lafargue s’abrite derrière l’analyse des opéras de Richard Wagner par Friedrich Nietzsche pour dénoncer, sans aucun inventaire, ce qu’il considère comme la «pesanteur» et l’«artifice» des techniques du corps. Le cœur de l’article oppose à ces inconvénients prétendus une «immersion dans la lumière», dont on est en droit de se demander si elle n’est pas seulement métaphorique ou même illusoire.
Ainsi, les tableaux de Jammes Turell «ne sont faits que d’ondes lumineuses». Certes, ils «sont entièrement poreux et traversables» (section 9). Par exemple, dans «les Perceptual Cells, sortes de cabines ressemblant à des cabines de téléphone, […] chaque visiteur peut régler l’intensité et la couleur monochrome des influx lumineux et expérimenter ses effets psychosomatiques». Ou encore, Heavy Water, «emménagé au fond d’une piscine en 1991 […] oblige le spectateur à plonger dans l’eau bleue d’une piscine pour s’immerger dans l’espace lumineux de la cellule, où il peut enfin respirer» (section 11).
Mais, dans le Roden Crater du Painted Desert d’Arizona, à l’est de San Francisco, «le visiteur est invité à gravir lentement le petit sentier qui serpente le long de ses parois pour expérimenter les variations de la lumière». Et c’est seulement «s’il parvient au faîte du volcan au moment où la lumière (du soleil ou de la lune) est à son zénith, [qu’]il aura la chance d’éprouver le sentiment immersif» (section 13). Plus encore, dans «les environnements de brumes lumineuses que Veronica Janssens réalise depuis bientôt trente ans», le spectateur «perd très vite tous ses repères corporels et psychiques. […] À mesure qu’il avance ou “involue”, il se sent quitté par ses “habitus”, qui le désignent aux yeux des autres comme à ses propres yeux. Ainsi “déshabité”, il est confronté à l’haptique d’une optique invisible qui l’obnubile et à l’optique d’un haptique insaisissable dont la densité le saisit» (sections 14-15).
Dont acte: il n’y a donc plus ni visible, ni sensible, ni récepteur… puisque le participant est «“déshabité”». En quoi y a-t-il donc «immersion», et pour qui? Au mieux, nous semble-t-il, pour l’intellect de quelques personnes cultivées comprenant abstraitement l’intention et, plus probablement, pour d’autres spectateurs qui, de l’extérieur, regardent «s’immerger» leurs camarades de visite. Pour la personne «immergée», ne serait-il pas plus exact de parler d’une approche de l’évanescence ou de la dissolution? C’est ce que pourraient suggérer les «nombreux accidents de spectateurs […] en proie à des pertes de repères et d’équilibre» (section 9).
.
Qu’on nous comprenne bien: ces pistes de recherche esthétique sont tout à fait respectables. Mais elles seraient beaucoup plus novatrices si elles incluaient la déstabilisation de l’hégémonisme du regard. Et surtout, elles ne peuvent pas prétendre occuper la place de toutes les autres recherches possibles sur l’immersion au sens propre, sur les véritables interactions entre systèmes sensoriels et sur chacun des sens autres que la vue.
Vers «une corporéité renouvelée»?
Au début du texte de Carole Hoffmann, on redoute le même glissement métaphorique, quand on lit que «les technologies numériques vont […] rendre possible de toucher avec les yeux, d’entendre avec la main et de voir avec l’oreille…» (page 503). Et le même dualisme entre corps et esprit, lorsque cette spécialiste des pratiques artistiques numériques affirme qu’«en déterritorialisant le corps, en le soumettant à l’apesanteur, à l’inconsistance, à l’impalpabilité et à l’absence de résistance des corps virtuels, [elles] provoquent des réponses multisensorielles» (page 506), passant notamment par la «distanciation de son propre corps» et par la «mise à distance physique vis-à-vis du corps de l’autre» (page 507).
On se réjouit que la chercheuse approfondisse sérieusement son hypothèse: «dès lors que le corps est prolongé par les technologies numériques interactives, ses modèles de perception et le rapport aux sens s’en trouvent modifiés, mais aussi le rapport que les sens entretiennent les uns avec les autres. La plasticité du corps lui permet de s’adapter à l’environnement et en mettant en place des processus vicariants, d’ouvrir sur une corporéité renouvelée et sur un univers de sensations inédites qui émerge de l’intersensorialité» (page 503). Deux des exemples qu’elle en donne concernent «le toucher dans l’interaction des sens» (page 509).
Avec Lights Contacts (2010) de Scenocosme, «les qualités tactiles, la proximité entre les gens sont […] traduites, dans leur dynamique, en variations sonores et lumineuses. L’objectif est “de mettre en œuvre une corrélation très étroite entre l’intensité des contacts et l’intensité de la musicalité et de la lumière engendrée […]. Toucher complètement la peau de l’autre provoque des sonorités à tonalités hautes. Si plusieurs personnes touchent ensuite cette même personne, les énergies s’additionnent et les sonorités grandissent encore en puissance tonale. Et au contraire si les corps se frôlent à peine et s’approchent à quelques centimètres sans jamais se toucher, alors les sonorités engendrées sont de basses tonalités, parfois proches du ronronnement”» (page 510). Dans une autre direction, le dispositif Sens III de Pedro Pauwels «articule des capteurs situés sur le corps des danseurs et des vibreurs disposés sur une plaque métallique sur laquelle reposent les pieds des spectateurs» (page 512).
.
Ces dernières recherches, encore très minoritaires, montrent qu’il est possible de faire autre chose qu’abstraire le corps du spectateur et modifier seulement sa vision. Il est bel et bien possible de jouer aussi sur la simulation ou sur la production de nouveaux perceptibles.
Références
Hoffmann, Carole, 2023, «Plasticité du corps: l’intersensorialité au feu des technologies numériques», dans Battesti, Vincent, et Candau, Joël (dirigé par), Apprendre les sens, apprendre par les sens. Anthropologie des perceptions sensorielles, Paris, Petra, pages 501-520.
Lafargue, Bernard, 2015, «L’alcyonisme des arts immersifs de Jammes Turell et Veronica Janssens contre “l’esprit de pesanteur” des “paradis artificiels” immersifs, des techniques du corps de “l’homme-pluvier” postmoderne et de l’acédie qui s’ensuit», Corps 13, pages 133 à 140.
Consulter l’article de Bernard Lafargue sur shs.cairn.info.
Bonus d’actualité
Deux articles de Télérama datés de 2021 et de 2025 permettent de mesurer la régression actuelle.
La plume anonyme du premier affirmait: «tactile, physique, contact: ces ingrédients indispensables à l’homme fondent l’expérience immersive», et promettait que «de plus en plus perfectionnées, des trouvailles technologiques équiperont des cobayes de capteurs (de bruits, de chaleur, de mouvements) pour qu’ils aient une appréhension amplifiée de leur environnement». Elle citait Bernard Andrieu: «“dans le virtuel, vous transgressez les possibles. Vous allez, ensuite, vouloir vivre la même chose dans le réel. Les dispositifs immersifs favorisent cette recherche de l’exaltation sensorielle.” À ne fréquenter qu’Internet, on se frustre du besoin d’être touché et de toucher. Et l’assouvissement virtuel des fantasmes accroît les exigences du corps qui traque dans le concret des intensités identiques». (telrama.fr)
Dans le second, au contraire, la chercheuse Charline Callet propose l’approche restrictive suivante: «l’art immersif peut être défini comme un langage esthétique et médiatique voué à effacer les frontières conventionnelles entre le spectateur et l’œuvre, en activant simultanément plusieurs canaux sensoriels (visuel, auditif, olfactif…), afin de produire une expérience incarnée». (Youness Bousenna, 2025, «“L’immersion est un outil, pas une finalité”», Télérama, 5 novembre, pages 20-21)
Vous avez dit «incarnée»? Mon doigt! Où ont bien pu passer le tact, la vibration, la kinesthésie?
Lire aussi sur notre site
Ce que pourrait être toucher avec les yeux,
Musées d’aujourd’hui, laissez votre peau au vestiaire,
Humaniser l’architecture, tout un processus
et Art contemporain, comment certaines tendances ont fait disparaître le corps.
Photographie d’illustration: Don d’archives personnelles.

Commentaires récents