En 1983, la fondation Claude Verdan présentait l’exposition La Main de l’homme. Préfiguration d’un musée. Le musée n’a toujours pas d’existence continue, mais la lecture du catalogue initial permet à l’AFONT de comprendre ce qui a manqué à ce projet voisin du sien. …
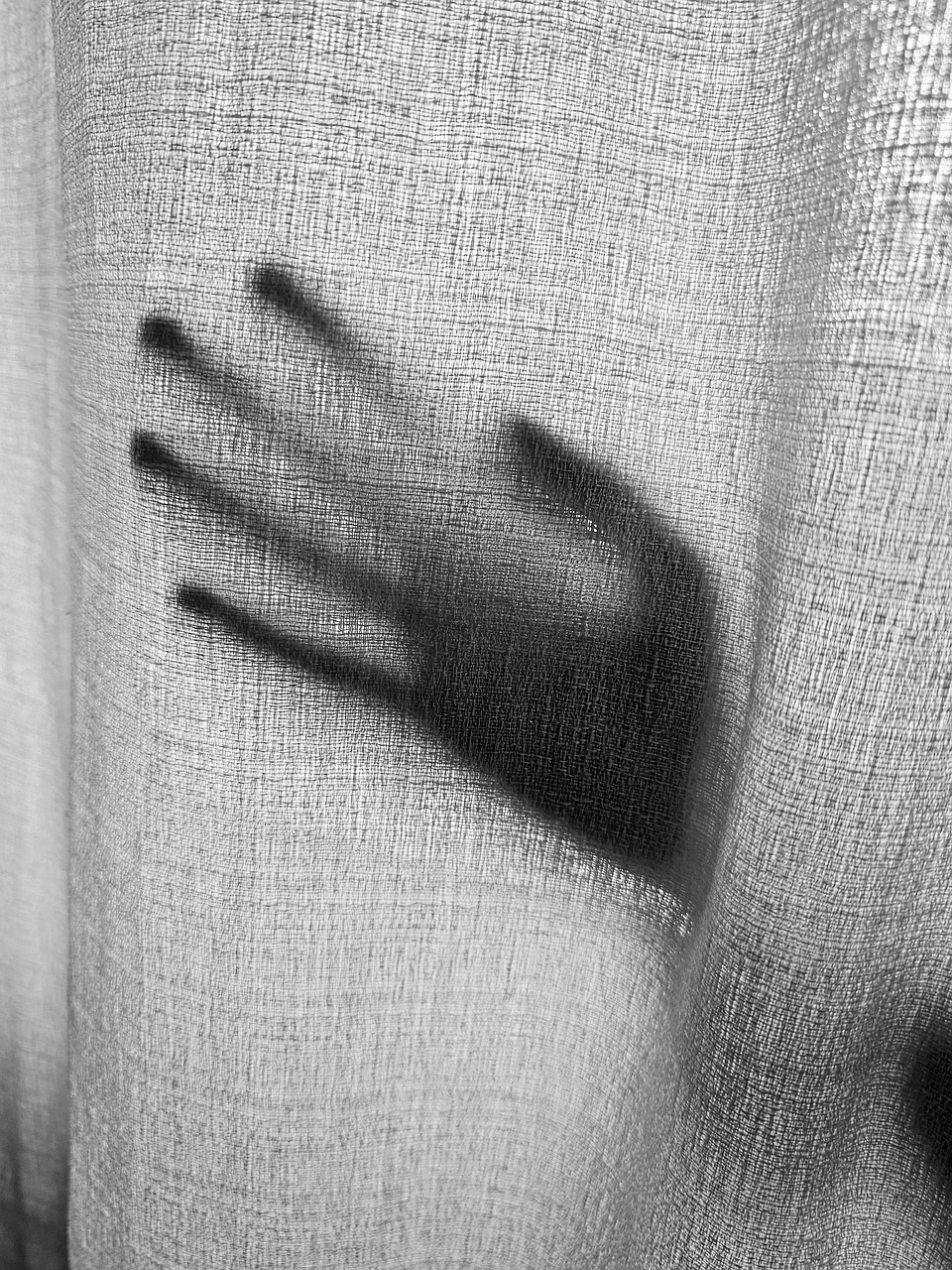
Le 13.05.1981, le chirurgien de la main et professeur de médecine Claude Verdan (1909-2006) créait la fondation qui porte son nom. Son principal objectif était d’édifier un «musée de la main», qu’il décrivait ainsi: «ce devrait être un centre permanent largement ouvert au public, et notamment aux étudiants, abritant certes diverses collections artistiques, artisanales, bibliographiques, photographiques et audiovisuelles consacrées à la main, mais encore et surtout un institut de recherche […] animé par la collaboration de chercheurs d’horizons variés, au premier rang desquels devrait se placer la chirurgie de la main» (pages 13-14). Il le déclinait en cinq thèmes, comme nos cinq doigts: «la main naturelle», «la main exercée», «la main et la culture», «la main et la société», «la main et le symbole» (page 14).
La collection initiale comportait 300 œuvres d’art et plus de 3000 diapositives (page 41). Selon le site www.museedelamain.ch, elle «compte à ce jour près de 1600 pièces: sculptures, moulages, peintures, gravures, sanguines, photographies, empreintes, affiches, outils, prothèses, pièces anatomiques, objets divers et utilitaires ornés de mains, etc.». Bien qu’elle soit hébergée depuis 1997 par l’Université de Lausanne (UNIL) et le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), «actuellement, cette collection n’est pas présentée dans les salles d’exposition du musée. Néanmoins, elle est valorisée par des prêts à d’autres institutions» et par des expositions temporaires qui ont donné matière à d’autres publications:
- Interprétation artistique de la main au cours des âges, 1985 ;
- Protéger la main au travail, 1985 ;
- La Main en neurologie, 1986 ;
- Jeux de mains, 1997 ;
- Du baiser au bébé, 2006 ;
- Peau, 2011 ;
- Touch: le monde au bout des doigts, 2012 ;
- Anatomies. De Vésale au virtuel, 2014.
La Main et le cerveau en neuropsychologie, 1986 ;
On ne peut que constater que la fondation et le musée se sont, ses dernières années, éloignés de leur objet, en se consacrant à d’autres sensations injustement minorées (Sel, 2013; Odeurs et sentiments, 2019) ou aux émotions (Pas de panique, 2014).
Mais surtout, en s’appuyant principalement sur les représentations que les arts visuels donnent de la main et en réduisant cet organe à un outil pour agir, évalué en terme de performance quantifiée, la démarche ramène inévitablement à l’ambivalence de l’action. Comme l’écrit une des contributrices, «la main est porteuse du meilleur et du pire» (Erika Berchtold-Heidecke, page 82). Elle omet cependant de mettre ce constat en rapport avec son postulat de départ: «l’âme est la source du vouloir –la main l’instrument du pouvoir» (page 73). On est d’ailleurs frappé par le caractère très majoritairement anxiogène des illustrations choisies.
Une discipline manquante, l’anthropologie, et un concept quasi absent, la perception
Nous donnons bien sûr acte au Musée de la Main du fait que ce n’est qu’en 1990 qu’a été formulé par Alain Corbin et David Howes le projet d’ensemble d’une histoire et d’une anthropologie sensorielles, et que c’est seulement à partir de 2007, avec le numéro 49 de la revue Terrain que se sont régulièrement succédés les travaux francophones concernant les perceptions tactiles et kinesthésiques. Force est de constater que ces apports capitaux n’ont pas été intégrés après coup, alors qu’ils auraient pu refonder la démarche que leur absence rend paradoxale.
De fait, dans le projet initial, la sensorialité est tantôt passée sous silence, tantôt évoquée en passant, tantôt reléguée en toute fin des différents articles: elle n’apparaît, notamment, qu’à la fin de l’«Introduction» de Claude Verdan (page 16) et n’est quelque peu développée que dans les deux dernières pages de la section «Éloge de la main» (pages 28 à 30). Le seul chapitre quelque peu substantiel est celui d’André Corboz (1928-2012), historien de la peinture, de l’architecture et de l’urbanisme. Or, en juxtaposant sans les hiérarchiser des éléments souvent contradictoires, il illustre parfaitement l’affirmation de David Le Breton pour qui «la subordination du sens à un savoir conçu sur le modèle de la vue, et rationalisé, amène nécessairement au dénigrement du toucher» (La Saveur du monde, 2006, page 177).
Quelques constats partagés
–«Nul doute […] que le tact ne soit aujourd’hui un sens relativement atrophié: dans notre économie sensorielle, il n’a guère que le rôle d’auxiliaire de la vue. Il existe une culture visuelle: on ne parle pas de culture tactile» (page 51). Certes, mais la vue n’a-t-elle pas dû être cultivée pour construire une culture? Les mots «aujourd’hui» et «atrophié» n’impliquent-ils pas qu’il a pu, et qu’il pourrait, en aller de même pour le tact?
–«Le tact devient une sorte de sens de la redondance: il lève certaines ambigüités que le regard ne serait pas capable de lever seul, ou pas aussi vite» (page 52). N’est-ce pas une première bonne raison de le cultiver?
–«Une même forme, perçue tactilement, [est] différente de sa perception par l’œil. Il n’y a pas de contradiction dans cette non-coïncidence des deux «formes» d’un même objet. Pas plus que dans la perception en partie double des deux mains» (page 56). Pourquoi, dès lors, accepter la «domination tyrannique du visuel» qui réduit la sculpture à l’«ambigüité fondamentale […] de restituer pour la vue une organisation intéressant d’abord le toucher»? (même page). N’est-ce pas, au contraire, une seconde bonne raison de cultiver le tact en lui-même et pour lui-même?
Plusieurs affirmations hasardeuses
–«Nous n’avons peut-être pas vécu assez longtemps dans les cavernes pour construire un modèle tactile de l’environnement qui serait l’équivalent du spectacle pour les yeux» (page 54). De nombreux travaux anthropologiques, notamment inspirés par David Howes, prouvent au contraire que la hiérarchie des sens varie selon les époques et selon les cultures.
–«Le tact n’a pas non plus d’axe rectiligne. Le toucher n’en construit pas: l’attache de la main et du bras implique la courbe. Lorsqu’il y a droite, c’est que la vue domine et réduit le toucher à sa volonté. […] Les distances, difficilement comparables, se conservent mal dans la mémoire du mouvement. Livré à lui-même, le tact coordonne avec peine. Comment instituerait-il, seul, des proportions?» (page 55). Les recherches ethnographiques sur les situations réelles de vue empêchée montrent au contraire les précieuses ressources de la mémoire kinesthésique (lire notamment Céline Rosselin et ses collaboratrices).
–«Ce sens de l’épaisseur ne connaît pas la loi sécurisante fondamentale de la vue: le mécanisme de constance, qui corrige nos sensations. Pour l’œil, les relations qui tissent le milieu sont toujours sous contrôle. Avec le tact livré à lui-même, pas de persistance dans la perception des relations: elles ne sont pas présentes simultanément. Rien n’est assuré, tout ne cesse de se conquérir, de se refaire et de se perdre» (page 55). C’est ce que dément formellement la «Petite aventure en pleine nuit» de Jean Paulhan.
–«Peu capable d’abstraire, c’est-à-dire de procéder à une opération de survol, de classement, de permutation, –de choix? Tout entier à l’étage du vécu, il colle à l’objet. Il nous assure la «forme» permanente des choses. Est-ce pour cela qu’il est si peu imaginatif? À peine quitte-t-il sa prise qu’il s’égare. Objectif; concret» (page 58). Dès 1938, Paul Valéry argumentait fortement la thèse opposée.
De telles contradictions renforcent l’AFONT dans son pari qu’accorder la priorité à la sensation corporelle et à la perception cérébrale reste la voie la plus sûre pour échapper à l’ambivalence du contact grâce à une approche qualitative et différenciée du tact.
Référence
Corboz, André, 1983, «Tactile», dans Verdan, Claude, et Rodari, Florian, (dirigé par), La Main de l’homme. Préfiguration d’un musée, Lausanne, musée de l’Élysée et Fondation Claude Verdan, pages 49-58.
Lire également sur notre site
Éduquer les mains: intuition et raison,
La Fondation Jean-Jaurès s’intéresse politiquement au sens du toucher,
L’Éloge de la main de Jean-Philippe Pierron, pour une tactilité écocitoyenne,
Le toucher, une friche éducative à mettre en culture
et Tactae, collectif international et interdisciplinaire sur le toucher.
Photographie d’illustration: pati_goldberg pour Pixabay.com

Commentaires récents