«À n’en pas douter, un vol dans l’espace peut radicalement changer un corps. Celui-ci devient “fragilisé” et “transformé”, en ce qu’il aura été déshabitué aux sensations terrestres». Julie Patarin et Jean-François Clervoy décrivent cet «usage différent des cinq sens»
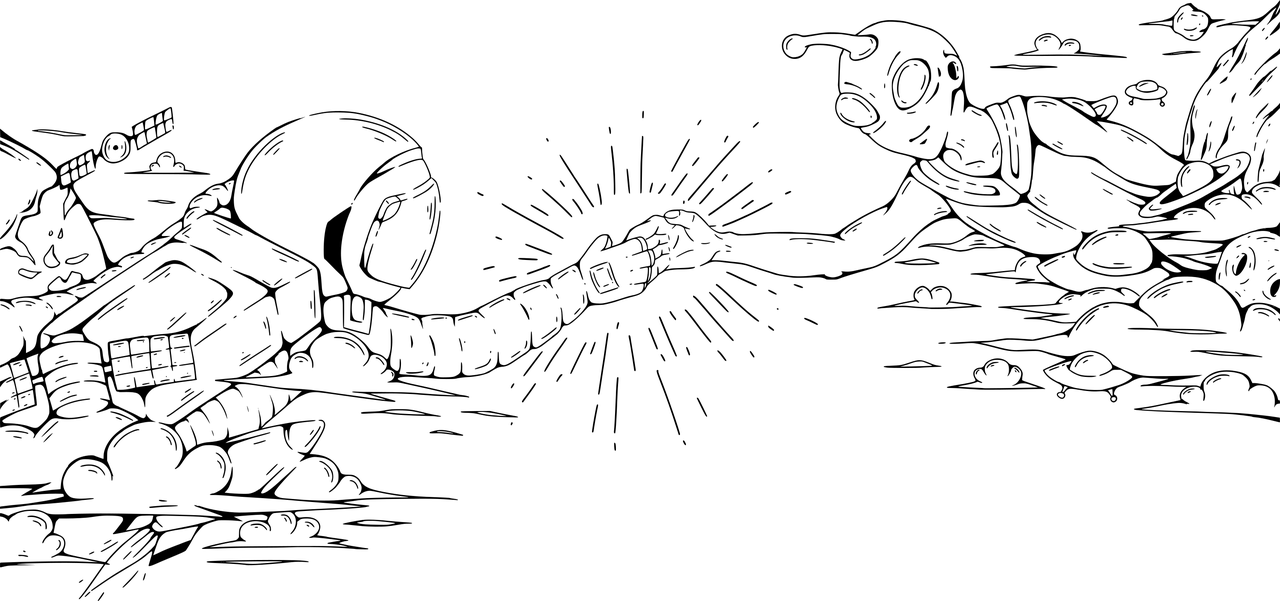
Dans un chapitre du recueil collectif Apprendre les sens, apprendre par les sens (2023), l’astronaute Jean-François Clervoy raconte son expérience de vol et l’anthropologue Julie Patarin-Jossec ethnographie les entraînements préalables à de telles performances. On est très loin des excursions pour milliardaires et des tentations colonisatrices qui font rêver certains médias. «Conçu comme un processus d’incorporation où se font et se défont certaines habitudes gestuelles, et où le corps et ses réactions doivent être constamment réappropriés sous l’égide d’une discipline martiale, le vol spatial est ici analysé comme une éducation charnelle et sensorielle indissociable des espaces que les astronautes traversent au fil de leur carrière» (page 320).
Perturbations de l’interaction entre les systèmes sensoriels
En apparence, la suprématie classiquement enseignée de la vision et de l’audition se trouvent seulement exacerbées par les conditions de vol. «Le corps n’ayant plus de sensation de poids et ne reposant plus sur aucune surface, l’on en vient vite à l’oublier. La vue et l’ouïe deviennent alors les dernières attaches dans le rapport de l’astronaute à son corps» (page 323). En particulier, «l’ouïe devient […] un organe sensoriel vital pour alerter l’astronaute d’une anomalie éventuelle. Il a appris à reconnaître ces sons caractéristiques pendant son entraînement, équipé de ce même scaphandre placé dans une chambre reproduisant le vide spatial. Comme pour les pannes du vaisseau, les anomalies sont en principe détectées par des capteurs dédiés, lesquels déclenchent des alarmes visuelles et sonores. L’on comprend alors pourquoi les critères de sélection des astronautes sont si sévères sur la vue et l’ouïe (alors qu’aucun test ne semble s’intéresser au goût, à l’odorat ou au toucher)» (page 324).
Cependant, la vue, qu’on se plaît à représenter comme souveraine et autonome, ne constitue pas, à elle seule, un repère suffisant. De fait, «les vestibules et les canaux semi-circulaires de l’oreille interne –ces capteurs sensoriels qui régulent l’équilibre du corps– perdent subitement toute référence. Les informations envoyées au cerveau ne sont plus corrélées avec celles de la vision. Ce conflit neurosensoriel déclenche un “mal de l’espace” chez la moitié des astronautes» (pages 322-323). Et les sens qu’ils ignorent d’ordinaire se rappellent désagréablement à eux: «affranchi des règles de la pesanteur terrestre, le sang circule en excès dans le haut du corps. La tête peut en devenir enflée jusqu’à alimenter de vives migraines et obstruer la respiration nasale, irrigant ainsi différemment les papilles gustatives et olfactives» (page 325).
«Ce que le vol fait aux corps», notamment à leur peau
Pendant le décollage, la combinaison étanche «outre d’être lourde et encombrante, est d’autant moins confortable que l’on se trouve recroquevillé dans un siège incliné vers le sommet de la fusée. Le premier sens sollicité est donc celui du toucher. Sur toute sa surface, le corps est contraint dans cet ensemble fait d’épaisseurs multiples, connecté à des câbles et tuyaux d’alimentation. Les mouvements sont des plus limités. Et, contrairement aux positions assises ou debout, où la pression s’exerce sur les fessiers ou les plantes des pieds, le dos subit ici tout le poids de l’attirail bientôt aggravé par la prise de vitesse» (pages 320-321). «L’augmentation du nombre de g qui s’ensuit ne tarde pas à empêcher l’accès des mains au pupitre de commandes» (page 321). (Pour rappel, les g mesurent le facteur de charge exercé sur le corps par l’accélération, la décélération et le changement de direction.)
Au cours du vol, «l’arrivée précipitée en apesanteur (0 g) retire soudainement toute sensation de poids au corps. Les bras, qui pesaient très lourd sur le torse quelques secondes auparavant, sont tout d’un coup projetés vers l’avant en réaction à l’absence de pesanteur» (page 322). «Le toucher ne nous rappelle que l’on possède un corps physique que par les actions régulières effectuées sur les interrupteurs, touches de clavier ou manches de pilotage» (page 336). Or «cette absence de poids fragilise progressivement la peau, privée de pression régulière dans le quotidien. Elle reprend une texture de nouveau-né incroyablement sensible aux frottements, nécessitant une attention particulière avant toute activité physique (telle que le sport ou une sortie dans le vide)» (page 323). En contrepartie, «les gants [du scaphandre de sortie dans l’espace], outrageusement compressés, réduisent à néant la tactilité. Pour cependant maintenir un minimum de dextérité, ils sont ajustés à la longueur précise de chaque doigt –ce qui génère souvent, après coup, des douleurs insupportables sous les ongles et augmente à outrance la sensibilité du toucher» (page 324).
Au retour dans l’atmosphère, «ayant oublié la sensation du poids des choses, y compris de soi-même, tout devient effroyablement lourd. Ne serait-ce que lever son bras, pourtant un geste du quotidien sur terre, mais réappris sans pesanteur durant le vol, demande un effort considérable » (page 327). Les trois pages suivantes énumèrent les séquelles de ces missions, depuis les engelures et pertes d’ongles jusqu’au mal de dos, «les disques intervertébraux s’allongeant et les muscles ventraux s’atrophiant sans le poids de la gravité». On comprend ainsi que le retour de vol puisse constituer «un apprentissage à refaire» (page 328).
Référence
Patarin-Jossec, Julie, et Clervoy, Jean-François, 2023, «Une discipline du sensible: le rapport aux sens dans l’apprentissage et l’expérience de vol des astronautes», dans Battesti, Vincent, et Candau, Joël (dirigé par), Apprendre les sens, apprendre par les sens. Anthropologie des perceptions sensorielles, Paris, Petra, pages 317-340.
Lire aussi sur notre site
Tactilité des débuts de l’aviation, Antoine de Saint-Exupéry
et Piloter aux fesses, ou avec trois doigts.
Dessin d’illustration: Keneeko pour Pixabay.com

Commentaires récents